
Dénomination sociale : définition, obligation, et choix
Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Au moment de la création d'entreprise, chacune des personnes qui réalise un apport à destination de l’entreprise acquiert la qualité d’associé. Cet apport peut être une somme d’argent (apport en numéraire), un bien meuble ou immeuble (apport en nature) voire même la mise à disposition d’un savoir-faire ou de compétences (apport en industrie).
Lors de la constitution de la société, les associés promettent d’apporter tel bien ou telle somme à la société. Cependant, ce n’est que lors de la libération du capital que la société se voit effectivement remettre les apports.
Définition, fonctionnement, conditions et délais, Legalstart vous dit tout sur la libération du capital social.
Mini-Sommaire
Le capital social d’une entreprise représente la valeur totale des biens et sommes d’argent que les associés ont annoncé apporter à la société lors de sa constitution. À ce titre, il est important de distinguer :
📝 À noter : le capital souscrit appelé fait référence à la partie du capital souscrit qui n’a pas encore été libéré. Le dirigeant de la société peut alors appeler les associés à réaliser les versements complémentaires.
📌 À retenir : le capital libéré, en définition, est la partie du capital qui est effectivement apporté par les associés. Il peut correspondre en tout ou partie au capital souscrit.
En principe, la libération doit être immédiate et intégrale ce qui signifie que la souscription et la libération du capital s’opèrent au même moment.
Toutefois, dans le cadre d’un apport en numéraire, c’est-à-dire d’une somme d’argent, il est possible de ne procéder qu’à une libération partielle du capital au moment de la constitution. Le reste pouvant être libéré de manière différée.
Le délai de libération du capital social en cas de libération partielle prévue dans les statuts de la société varie en fonction de la forme sociale.
🛠️ En pratique : la date butoir pour le versement complet des apports est précisée dans les statuts. Cependant, cette date ne peut pas être ultérieure au délai maximum légal de libération du capital.
La libération du capital social en SAS peut être étalée dans le temps.
Cependant, au moins la moitié (50%) de l’intégralité des apports doit être versée le jour de l’inscription de la SAS au greffe. L’autre moitié doit être libérée, en un seul ou plusieurs versements, dans les 5 ans.
☝️ Bon à savoir : les sociétés anonymes (SA) sont soumises au même principe. Ainsi, la libération minimum du capital d’une SA lors de la constitution de la société est de 50 %.
En SARL, la libération du capital peut également être effectuée en un ou plusieurs versements.
Au moins un cinquième (20%) de la totalité des apports doit être libéré au moment de l’immatriculation de la société au RCS. La libération du surplus doit intervenir dans un délai maximal de 5 ans, en une ou plusieurs fois.
📝 À noter : le capital social de la SARL doit être entièrement libéré avant de pouvoir envisager toute nouvelle souscription de parts, c’est-à-dire une augmentation du capital social.
Les règles applicables sont les mêmes pour l’EURL.
Dans le cadre d’une SCI (société civile immobilière), la loi ne prévoit aucun délai légal dans lequel les associés sont tenus de libérer leurs apports en numéraire. Les associés bénéficient donc d’une importante liberté.
Ce sont les statuts de la SCI, ou un acte annexe, qui doivent prévoir la proportion des apports qui doit être libérée immédiatement et le délai dans lequel le reste doit être versé.
|
Forme sociale |
Apport en numéraire |
Apport en nature |
|
|
Montant devant être versé à la constitution |
Délai de libération du solde |
||
|
SAS |
50% |
5 ans |
Libération intégrale dès la souscription |
|
SARL |
20% |
5 ans |
|
|
SCI |
- |
Pas de délai légal |
|
Concernant la libération du capital social, les formalités à accomplir se composent de plusieurs étapes.
Tout d’abord, les associés doivent souscrire au capital social, c’est-à-dire s’engager à réaliser un apport d’un certain montant. Cet engagement est pris lors de la signature des statuts constitutifs de la société.
Ensuite, le capital social doit être appelé. Les démarches à réaliser dépendent alors de s’il s’agit de la part du capital social à apporter obligatoirement au moment de la création de la société ou d’un apport réalisé plus tard.
Pour la partie du capital social qui doit être apportée dès la constitution de la société, cet appel se fait lors de la demande du dépôt du capital social. En effet, la fourniture d’un certificat de dépôt du capital social est obligatoire pour pouvoir procéder à l’immatriculation de la société.
D’autre part, si la libération du capital social est partielle, la procédure pour libérer le solde est la suivante :
⚠️ Attention : en cas de libération partielle du capital, il appartient au dirigeant de la social de faire l’appel de capital dans les délais impartis. À défaut, il peut voir sa responsabilité engagée.
Pour les associés, prévoir une libération partielle du capital social dans les statuts constitutifs offre plusieurs avantages. Le premier avantage est que cette possibilité permet aux associés d’afficher un capital social conséquent qui inspire confiance, tout en bénéficiant davantage de temps pour réaliser les apports. Ainsi, si les associés ne disposent pas des fonds suffisants au moment de la création de la société pour constituer le capital social mentionné dans les statuts, ils bénéficient d’un délai supplémentaire allant généralement jusqu’à 5 ans pour verser la totalité.
En outre, la libération partielle du capital permet de s’assurer de la bonne utilisation des fonds apportés. Il est plus facile de respecter le prévisionnel et le budget quand les apports sont réalisés au fur et à mesure, car il est moins tentant de tout dépenser dans les premiers mois ou dans les premières années.
Cependant, la libération partielle du capital social présente aussi des inconvénients. Cela peut être risqué de s’engager à verser une somme d’argent que l’on ne détient pas encore. Or, l’associé qui ne respecte pas son engagement s’expose à des sanctions.
Par ailleurs, tant que la libération du capital n’est pas complète, si la société est imposée à l’impôt sur les sociétés (IS), elle ne peut pas bénéficier du taux réduit de 15 % jusqu’à 42.500 € de bénéfices. Seul le taux normal de 25 % s’applique.
Le capital social a différentes fonctions. Il constitue notamment une garantie pour les créanciers, en particulier dans les sociétés où la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (SAS, SARL, etc.).
C’est pourquoi, si à l’échéance prévue par la loi (ou, à défaut les statuts) les associés n’ont pas versé la somme promise, ils peuvent être tenus de verser des intérêts sur les sommes dues.
D’autre part, si la société a subi un préjudice, les associés n’ayant pas libéré leurs apports peuvent être sanctionnés par le paiement de dommages et intérêts ou par la mise en vente des actions non libérées, afin d’exclure l’associé qui n’a pas respecté son engagement.
Une fois le capital social déposé auprès d’une personne habilitée (notaire, avocat, banque) en vue de la création de la société, vous pouvez récupérer le capital social pour le verser sur le compte bancaire de la société si les deux conditions suivantes sont réunies : la société a bien été immatriculée, et les fonds ont été déposés depuis au moins 15 jours.
La comptabilisation de la libération du capital nécessite la réalisation de plusieurs écritures comptables :
Les capitaux propres d’une société sont constitués :
Principale source législative et réglementaire :
Léna Cazenave
Diplômée d'un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle de l'Université d'Aix-Marseille.
Sous la direction de Pierre Aïdan, docteur en droit et diplômé de Harvard.Fiche mise à jour le
Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Téléchargez notre guide gratuit sur la création d'entreprise
Ces articles pourraient aussi vous intéresser :

Dénomination sociale : définition, obligation, et choix

Comment déposer le nom de son entreprise en 2025 ?
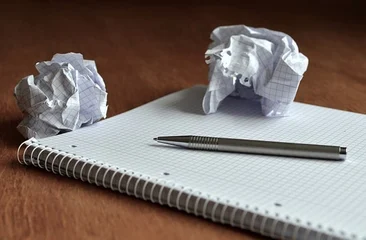
Raison sociale : le mode d'emploi 2025

Apport en nature en SAS : définition, fonctionnement et évaluation
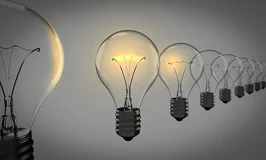
Exemples de dénomination sociale : méthode et modèles

Nom commercial : définition, choix et protection
On a besoin de vous !
Si vous appréciez notre contenu, un avis sur Google nous aiderait énormément !